

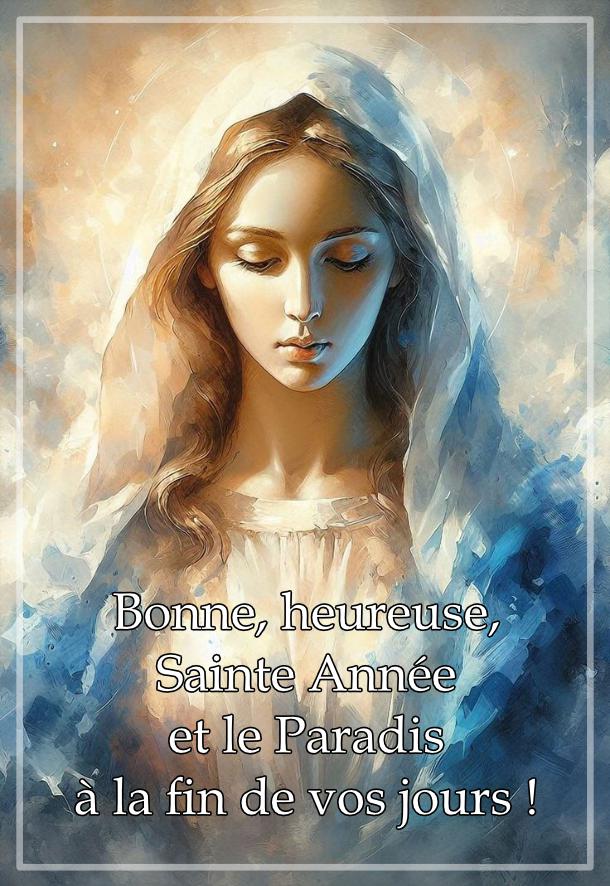
Noël selon Charles Péguy

Chaque poutre du toit était comme un vousseau.
Et ce sang qui devait un jour sur le Calvaire
Tomber comme une ardente et tragique rosée
N'était dans cette heureuse et paisible misère
Qu'un filet transparent sous la lèvre rosée.
Sous le regard de l'âne et le regard du bœuf
Cet enfant reposait dans la pure lumière.
Et dans le jour doré de la vieille chaumière
S'éclairait son regard incroyablement neuf.
Et ces laborieux et ces deux gros fidèles
Possédaient cet enfant que nous n'avons pas eu.
Et ces industrieux et ces deux haridelles
Gardaient ce fils de Dieu que nous avons vendu.
Et les pauvres moutons eussent donné leur laine
Avant que nous n'eussions donné notre tunique.
Et ces deux gros pandours donnaient vraiment leur peine.
Et nous qu'avons-nous mis aux pieds du fils unique ?
Ainsi l'enfant dormait sous ce double museau,
Comme un prince du sang gardé par des nourrices.
Et ces amusements et ses jeunes caprices
Reposaient dans le creux de ce pauvre berceau.
L'âne ne savait pas par quel chemin de palmes
Un jour il porterait jusqu'en Jérusalem

Les bénédictines de l’Emmanuel à Bethléem, entre Orient et Occident
Accroché aux collines de Bethléem, le monastère de l’Emmanuel se tient à l’écart du tumulte, dans un paysage minéral ouvert sur l’horizon biblique de la Judée. Fondé au début des années 1960, ce monastère grec-melkite catholique appartient à la tradition bénédictine vécue selon le rite byzantin. Son nom, Emmanuel — "Dieu avec nous" — résonne avec une force particulière dans cette terre marquée par l’Incarnation autant que par les fractures de l’histoire.
La communauté de moniales y mène une vie de prière et de contemplation, rythmée par la liturgie byzantine chantée, l’oraison silencieuse et le travail quotidien. Elle s’enracine dans un double héritage, oriental et occidental, faisant du monastère un lieu de passage, de fidélité et de dialogue entre les traditions chrétiennes.
Lieu d'accueil et d'hospitalité, le monastère de l'Emmanuel est situé juste en face du mur de séparation construit par Israël dès 2002, après la seconde Intifada. Cette structure massive de béton, haute jusqu'à onze mètres par endroits, est entrecoupée de miradors, de routes militaires et de points de contrôle. Visible depuis plusieurs quartiers et institutions, dont des lieux religieux, il marque physiquement et psychologiquement le paysage — une présence lourde, silencieuse, qui rappelle que cette terre sainte reste profondément traversée par le conflit. Derrière ces murs, le monastère de l’Emmanuel n’est pas un refuge hors du monde, mais une présence priante au cœur d’une région blessée. Par leur stabilité, leur hospitalité discrète et leur intercession, les sœurs offrent un témoignage discret mais joyeux : celui d’une espérance qui demeure, là même où Dieu a choisi de se faire proche.
Cécile Séveirac – Aleteia

![]()
Ave Maria
Chants grégorien pour le temps de Noël
![]()
![]()
MÉDITER SUR LES SAINTES ÉCRITURES...
durant le mois de jamvier
(extraits)LA PRÉPARATION DE
L’INCARNATION
Dans cet article, le P. HENRY JAMES COLERIDGE S.J. dresse une rare et judicieuse synthèse globale de toutes les prophéties de l’Ancien Testament en les ramenant en une seule : la venue du Messie promis. Tout l’Ancien Testament, dans ses faits, gestes, paroles, personnages et institutions nous parle de Lui : Jésus-Christ.
" Maintenant, Souverain Maître,
tu peux, selon ta parole,
laisser ton serviteur s'en aller en paix ;
car mes yeux ont vu ton salut,
que tu as préparé à la face de tous les peuples,
lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. "
![]()
« La vérité est née de la Vierge Marie »
Saint Augustin explique avec une heureuse concision : « Qu’est-ce-que la vérité ? Le Fils de Dieu. Qu’est-ce que la terre ? La chair. Demande-toi d’où est né le Christ, et vois pourquoi la vérité a germé de la terre… la vérité est née de la Vierge Marie » (En. in Ps. 84, 13).
Et dans un discours sur Noël, il affirme : « Avec cette fête qui revient chaque année, nous célébrons donc le jour où s’est accomplie la prophétie : “La vérité a surgi de la terre et la justice s’est penchée du ciel”. La Vérité qui est dans le sein du Père a surgi de la terre parce qu’elle fut aussi dans le sein d’une mère. La Vérité qui régit le monde entier a surgi de la terre parce qu’elle fut soutenue par les mains d’une femme…
La Vérité que le ciel ne suffit pas à contenir a surgi de la terre pour être couchée dans une mangeoire. À l’avantage de qui un Dieu si sublime s’est-il fait si humble ? Certainement avec aucun avantage pour lui, mais avec un grand avantage pour nous, si nous croyons » (Sermones, 185, 1).
Saint Augustin (354-430)
À méditer ...
« Tu as fait resplendir cette nuit des clartés de la vraie lumière » (Prière d'ouverture de la messe)
« Un silence paisible enveloppait toute chose, et la nuit était au milieu de son cours rapide. Alors ta Parole toute-puissante, Seigneur, est venue de ton trône royal » (Sg 18,14-15). Ce texte de l'Écriture désigne le temps très saint où la Parole toute-puissante de Dieu est venue jusqu'à nous pour nous parler de notre salut. Partant du secret le plus intime du Père, elle est descendue dans le sein d'une mère... La Parole de Dieu vient donc à nous de son trône royal ; elle s'abaisse pour nous élever ; elle s'appauvrit pour nous enrichir ; elle se fait homme pour nous diviniser.
Cette Parole avait dit : Que le monde soit, et le monde a été fait ; elle avait dit : Que l'homme soit, et l'homme a été fait. Mais ce qu'elle avait créé, la Parole ne l'a pas recréé aussi facilement. Elle a créé par son commandement, mais elle a recréé par sa mort. Elle a créé en commandant, mais elle a recréé en souffrant. « Vous m'avez donné bien de la peine », dit-elle (cf Ml 2,17). L'univers, dans toute sa complexité, ne m'a donné aucune peine pour l'organiser et le gouverner, car « je déploie ma vigueur d'un bout du monde à l'autre et je gouverne l'univers avec douceur » (Sg 8,1). Seul l'homme, violateur de ma loi, m'a donné de la peine, avec ses péchés. C'est pourquoi, venant du trône céleste, je n'ai pas refusé de me renfermer dans le sein d'une vierge et de m'unir en une seule personne avec l'humanité déchue. Dès ma naissance on m'enveloppe de langes, on me couche dans une mangeoire parce qu'il n'y a pas de place à l'auberge pour le Créateur du monde...
Toutes choses étaient plongées au milieu du silence, c'est-à-dire entre les prophètes qui ne parlaient plus et les apôtres qui parleront plus tard... Que la parole du Seigneur vienne encore maintenant vers ceux qui font silence. Écoutons ce que le Seigneur nous dit au fond de nous-mêmes. Que les mouvements et les cris malencontreux de notre chair se taisent, que les images désordonnées de notre spectacle intérieur fassent silence, pour que nos oreilles attentives écoutent librement ce que dit l'Esprit, pour qu'elles écoutent la voix qui est au-dessus du firmament.
Julien de Vézelay (v. 1080-v. 1160) moine bénédictin
« Tous disaient : Que sera donc cet enfant ? »
Quelle sera la gloire du juge, si la gloire du héraut est si grande ? Quel sera celui qui doit venir comme la voie (Jn 14,6), si tel est celui qui prépare la voie ? (Mt 3,3)... L'Église considère la naissance de Jean comme particulièrement sacrée ; on ne trouve aucun des saints qui nous ont précédés dont nous célébrons solennellement la naissance, nous ne célébrons que celle de Jean et celle du Christ... Jean naît d'une vieille femme stérile ; le Christ naît d'une jeune fille vierge. L'âge des parents n'était plus favorable à la naissance de Jean ; la naissance du Christ a lieu sans l'union des sexes. L'un est prédit par un ange ; l'autre conçu par la voix de l'ange... La naissance de Jean rencontre l'incrédulité, et son père devient muet ; Marie croit à celle du Christ, et elle le conçoit par la foi...
Jean apparaît donc comme une frontière placée entre les deux Testaments, l'Ancien et le Nouveau. Qu'il forme une sorte de frontière, le Seigneur lui-même l'atteste lorsqu'il dit : « La Loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean » (Lc 16,16). Jean représente donc à la fois ce qui est ancien, comme ce qui est nouveau. Parce qu'il représente les temps anciens, il naît de deux vieillards ; parce qu'il représente les temps nouveaux, il se révèle prophète dès le sein de sa mère (Lc 1,41)... Il apparaît déjà comme le précurseur du Christ, avant même qu'ils se voient. Ces choses-là sont divines et elles dépassent la capacité de la faiblesse humaine.
Enfin sa naissance a lieu, il reçoit son nom, et la langue de son père est déliée. Il faut rattacher ces événements à leur symbolisme profond.
Saint Augustin
«Je te salue, Comblée-de-grâce»
Comment parler ? Quel éloge pourrais-je faire de la Vierge glorieuse et sainte ? Elle surpasse tous les êtres, Dieu seul excepté ; par nature, elle est plus belle que les chérubins, les séraphins et toute l'armée des anges. Ni la langue du ciel, ni celle de la terre, ni même celle des anges ne suffiraient à la louer. Bienheureuse Vierge, colombe pure, épouse céleste..., temple et trône de la divinité ! Le Christ, soleil resplendissant au ciel et sur terre est à toi. Tu es la nuée lumineuse qui a fait descendre le Christ, lui l'éclair étincelant qui illumine le monde.
Réjouis-toi, comblée de grâce, porte des cieux ; c'est de toi que parle l'auteur du Cantique des Cantiques...quand il s'exclame : « Tu es un jardin clos, ma sœur, mon épouse, un jardin fermé, une source scellée » (4,12)... Sainte Mère de Dieu, brebis immaculée, tu as mis au monde l'Agneau, le Christ, le Verbe incarné en toi... Quelle merveille étonnante dans les cieux : une femme, revêtue du soleil (Ap 12,1), portant en ses bras la lumière !... Quelle merveille étonnante dans les cieux : le Seigneur des anges, devenu petit enfant de la Vierge. Les anges accusaient Ève ; maintenant ils comblent Marie de gloire car elle a relevé Ève de sa chute et fait entrer aux cieux Adam chassé du Paradis...
Immense est la grâce donnée à cette Vierge sainte. C'est pourquoi Gabriel lui adresse d'abord ce salut : « Réjouis-toi, comblée de grâce », resplendissante comme le ciel. « Réjouis-toi, comblée de grâce », Vierge ornée de vertus sans nombre... « Réjouis-toi, comblée de grâce », tu désaltères les assoiffés à la douceur de la source éternelle. Réjouis-toi, sainte Mère immaculée ; tu as engendré le Christ qui te précède. Réjouis-toi, pourpre royale ; tu as revêtu le roi du ciel et de la terre. Réjouis-toi, livre scellé ; tu as donné au monde de lire le Verbe, le Fils du Père.
Saint Épiphane de Salamine

TRAITÉ DE L'ORAISON ET DE LA MÉDITATION
24 - L'ACTION DE GRÂCE
![]()
![]()
LA RÈGLE DE SAINT-BENOÎT

![]()